«Richard Dindo ou les enquêtes véridiques»
Caméra-stylo, programme n°8
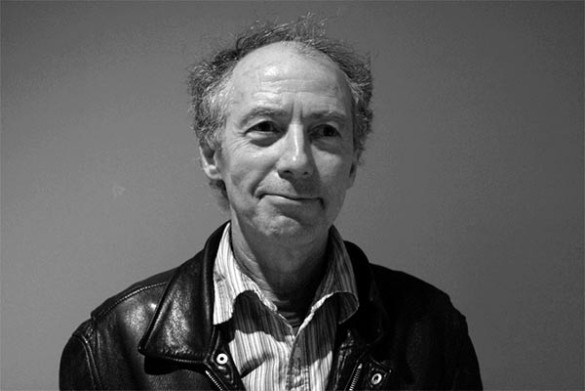
Un premier signe qui ne trompe pas: la lucidité dont fait preuve Richard Dindo pour expliciter sa vocation de cinéaste! Né petit-fils d’immigré italien, en 1944, à Zurich, le jeune Dindo s’est ressenti étranger en Suisse… Faire du cinéma, à fortiori documentaire, va alors constituer une manière de réconciliation avec le pays qui l’a rejeté; ce rejet se situe sans doute à l’origine de la forme cinématographique — quelque chose tenant de l’enquête imperturbable — dont va user le futur auteur de «Dani, Michi, Renato und Max». Une autre pièce à verser au dossier des origines est constituée par la Figure d’un père absent; laquelle, indirectement, va influer non seulement sur la forme, mais aussi sur les thèmes de l’œuvre à venir.
Une relecture de l’Histoire
Dès son deuxième long métrage, Des Suisses dans la guerre d’Espagne (1973), Dindo impose toutefois les dures conditions de la réconciliation: à savoir, une relecture de l’Histoire susceptible de mettre à jour les manquements de la Patrie; ce à quoi il s’applique en réhabilitant la mémoire des engagés volontaires suisses dans la guerre d’Espagne qui, à leur retour, furent jugés, et emprisonnés, par un Etat peu enclin à reconnaître l’Idéal comme circonstance atténuante!
Deux ans plus tard, Dindo persiste et signe en tournant «L’exécution du traître à la patrie Ernst S.» avec la collaboration du journaliste Niklaus Meienberg; ce faisant, il crée le grand principe qui va régir la structure de la plupart de ses films ultérieurs: l’enquête sur un personnage non représentable, du fait de sa mort, ou de son absence.
Revenant sur les lieux mêmes, Dindo collecte les témoignages des «acteurs de l’Histoire» et peut, dès lors, reconstituer au présent les circonstances de l’exécution de Ernst S. — qui fut condamné à mort pour avoir vendu quatre obus et une mine antichar à un officier nazi. Enfin, par le biais du montage, il confronte sa reconstitution avec des documents d’époque, et communique alors le sentiment, absolument indicible, que le cinéma peut être à même de faire jurisprudence!
De ce contre-pouvoir formidable, Richard Dindo en concevrait-il une certaine méfiance? c’est qu’il semble dorénavant éviter de filmer en «prises directes» avec l’Histoire: paradoxalement, ce retrait, qui ne sera que provisoire, va provoquer l’assomption définitive de sa démarche d’auteur.
La fiction du documentaire
Il revient au film «Max Frisch, Journal I-III» (1981) de révéler l’objet véritable, alors inattendu, de la méthode chère à Dindo, qui n’est autre que la reconnaissance du caractère irréductible de la subjectivité d’autrui; mais cette reconnaissance en appelle une autre, plus importante encore, et dont le cinéaste va désormais assumer toutes les conséquences formelles.
Cette reconnaissance, c’est celle du statut totalement fictionnel, qui fonde la pratique de Dindo; en résulte une manière de postulat fondamental pour tout le cinéma à vocation documentaire: à savoir que celui-ci ne peut en aucun cas prétendre à l’authenticité, dès lors qu’il se dissimule en tant que machine à fiction.
Partant, l’on comprend l’importance capitale que revêt l’absence du personnage principal — Frisch, Haufler dans Max Haufler, «Der Stumme» (1983) et, plus tard, Rimbaud — dont Dindo constitue le portrait contradictoire; par cette absence, le documentariste montre ainsi son jeu, qu’il joue seul ou avec d’autres — les femmes de Frisch, la fille de Haufler, la mère de Rimbaud, etc.
Une réflexion fondamentale
Avec «Dani, Michi, Renato und Max» (1987), Richard Dindo en revient pourtant à la volonté démonstrative d’antan, et prend d’autant plus de risques qu’il déconstruit pour la première fois une enquête dont l’Histoire n’a pas encore tiré toutes les conclusions. Evoquant, dans son dernier film en date, la figure immémoriale d’Arthur Rimbaud, Dindo reprend, là où il l’avait laissée, une réflexion dont Passion cinéma estime qu’elle sera sans doute fondamentale pour l’Histoire à venir du cinéma; reproduisant, au mot près, les paroles prononcées par l’entourage du poète, en son absence, le cinéaste les confronte à son désir, authentique, qu’il éprouve d’élucider, comme dans un film d’Hitchcock, le mystère qu’il prête à Rimbaud.